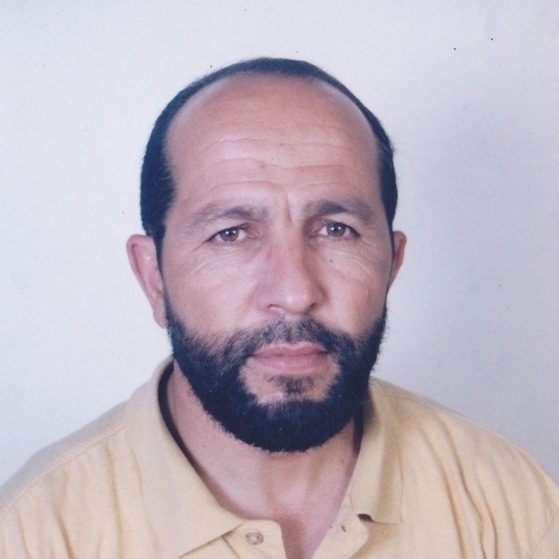Article Tahiri: Commentaire
Commentaire de l’article de Tahiri et al (2009) sur la zone de Rabat – Tiflet : « Geochronological data on the Rabat – Tiflet granitoids : their beiring on the tectonics of the Moroccan Variscides ».
La datation radiométrique et l’étude géochimique des granitoïdes de la zone de Rabat – Tiflet (ZRT) contribue à une meilleure compréhension de la géologie des terrains paléozoïques de la région, notamment l’histoire calédono-hercynienne. Ces granitoïdes jalonnent la Zone de Cisaillement Nord Mesetienne (ZCNM) qui correspond à une limite majeure entre un domaine hercynien au sud et le Bloc « calédonien » de Sehoul (BS) au nord (Piqué, 1979 ; El Hassani, 1990 ; Lakhloufi, 2007). Tout en précisant l’histoire géologique de la ZRT, les âges obtenus suite aux nouvelles datations des granites ont créé des zones d’ombres qui ont compliqué davantage la reconstitution du puzzle des événements géologiques de cette zone structurale au cours du Paléozoïque. L’âge hercynien précoce (Dévonien tardif) des granitoïdes de Rabat et l’âge protérozoïque tardif des granitoïdes de Tiflet (âges de l’article objet du commentaire) nécessitent un pertinent commentaire afin de mettre l’accent sur les sérieux problèmes que pose l’interprétation de ces âge dans l’article en question. Cette mise un point est obligatoire pour comprendre l’histoire paléogéographique calédono-hercynien de la région et son insertion dans le contexte géodynamique globale.
1- Bref aperçu sur l’état des connaissances
Pour que notre bref commentaire soit pertinent, un rappel succinct, utile, de certains traits fondamentaux de la géologie de cette région, tracés par les travaux antérieurs, s’avère nécessaire. L’âge calédonien de ces granitoïdes a été suggéré par Piqué (1979), puis confirmé par El Hassani (1990) après datation à base du K-Ar comme étant de 430 Ma. Par ailleurs, l’enjeu principal des différents travaux est de préciser la nature et l’histoire tectonique de la ZRT, la nature de la présumée « unité » chaotique, son extension et son âge, ainsi que les modalités d’ouverture et de fermeture du Bassin de Sidi Bettache (BSB) de Piqué (1979).
1.1- Place de la ZRT dans l’histoire du BSB
Selon Piqué (1979 – 1994) et El Hassani (1990), la ZRT a été structurée au Namuro – Westphalien en un anticlinal déjeté vers le sud (anticlinal de Rabat) que longent deux accidents de même vergence sous l’effet de la poussée du BS vers le sud. L’accident nord limite le présumé anticlinal avec le BS, alors que l’accident sud, appelé «Faille des Oulad Mimoun» (FOM) le limite avec le BSB. Cette dispositif structural serait hérité de la paléogéographie de cette zone, où des failles normales délimitent un graben étroit (Gouttière de Satour (GS)) entre le au nord et un horst du côté sud, appelé la ride Rabat – Tiflet (RRT) (Piqué, 1979 ; El Hassani, 1990). Le BSB et les autres bassins sédimentaires de la Meseta Occidentale (MO) seraient ouverts à la fin du Dévonien sous l’action d’un serrage ENE-WSW (Piqué, 1979; El Hassani, 1990; Bouabdelli et Piqué, 1996; Hoepffner et al., 2005; Simancas et al., 2009).
1.2- Réalité de l’« unité » (ou formation) chaotique
Rien qu’en passant en revue l’état des connaissances, la réalité de la nature sédimentaire de l’«unité» chaotique [formation chaotique de Piqué (1979)] peut être remise en cause. Décrite par Padgett et al. (1977), elle a été identifiée là où elle est représentée sur la Fig. 9D (article objet de ce commentaire), en tant que faciès de bas de pente d’escarpements de failles normales. Piqué (1979) l’a définie comme « formation » chaotique d’âge famenno – tournaisien, présente uniquement dans le sud de la région paléozoique de Rabat – Tiflet (RRT), à l’E de la région de Rabat ; pour lui, cette formation n’existe pas au sud du BS. L’auteur écarta aussi ce que Hamel (1968) avait décrit comme faciès chaotique d’âge cambrien moyen au sud de Rabat, en faisant appel à la chronologie relative de ses constituants. Pour lui, la formation chaotique est constamment en contact tectonique par la FOM avec les autres formations du BSB, notamment la «Formation de Korifla» du Famennien supérieur – Viséen inférieur, qui correspond à un faciès de plateforme distale (Izart et Vieselet, 1988). Par la suite, El Hassani et Zahraoui (1989) ont vu dans l’aspect chaotique des terrains de la banlieue sud de Rabat l’extension vers l’W de la formation chaotique. Cependant, El Hassani (1990) renonça à cette extension après que des termes calcaires de cet ensemble chaotique aient été datés du Viséen supérieur (Izart et Vieselet, 1988). Enfin, dans l’article objet du présent commentaire, ce faciès réapparaît de nouveau à la limite sud du BS, mais avec deux faits qui vont à l’encontre de ce qu’a été admis jusqu’nos jours : -le cachet syntectonique compressif des dépôts chaotiques, – le passage progressif de l’«unité» chaotique aux dépôts du BSB après suppression de la FOM sur la Fig. 1B. Ainsi donc, il apparait clairement que l’origine sédimentaire présumée de cette « unité » chaotique relève de la supposition et non de faits indubitables de terrain.
1.3- A propos du comportement de la ZRT durant l’histoire du BSB
Tout d’abord, la Zone paléozoïque de Rabat – Tiflet a constitué, selon tous les auteurs, une marge distensive comme limite nord du BSB (Padgett et al. 1977 ; Piqué, 1979 ; Cailleux et al., 1984 ; Izart et Vieslet, 1988 ; Lakhloufi, 1988 ; El Hassani et Zahraoui, 1989 ; El Hassani, 1990 ; Tahiri, 1991 ; Lakhloufi, 2002).
D’autre part, Cailleux et al. (1984) ont écarté le caractère chevauchant de vergence sud post viséen des accidents de la ZRT, et par conséquent le chevauchement du BS vers le sud. Pour ces auteurs, il ne s’agit que de phénomènes locaux, subordonnés à un jeu décrochant dextre d’une zone de cisaillement où deux événements tectoniques se sont succédés: des accidents décrochants dextre N070 que décalent en dextre des N120 néoformés, dextres à composante inverse de vergence sud.
Enfin, nos investigations au niveau de la ZRT et du « BSB » (Lakhloufi et al., 2000; Lakhloufi et al., 2001; Lakhloufi, 2007) montrent:
– d’autres importants affleurements de granitoïdes, découverts au niveau de la ZRT; il s’agit des granites de Msellat (du côté de Tiflet), à l’E de ceux de Rabat d’âge 367 Ma et des granites de l’oued Grou (du côté de Rabat), à l’W de ceux de Tiflet d’âge 605 – 609 Ma;
– une coupe géologique (lithostratographique) dans la banlieue sud de Rabat montre que le chevauchement du BS vers le sud est d’âge hercynien précoce (fin Dévonien);
– que lors de la structuration du BSB, postérieurement au Viséen, le BS n’a fait que coulisser en dextre par rapport à la Meseta occidentale (MO); la ZRT s’est comportée comme une mégazone de cisaillement de vergence vers le nord, fortement pentée vers le sud [Zone de Cisaillement Nord Mesetienne], d’un rejet minimal de plus de 30 Km;
– qu’au sein de la ZCNM, la dilacération et la dislocation des roches à toutes les échelles d’observation, a engendré un mélange chaotique de roches allant du Cambrien moyen au Viséen supérieur, de nature purement tectonique;
– que la partie orientale du BSB (au sud du BS) ne s’est ouverte qu’au Viséen moyen lors d’une extension N-S, alors que sa partie occidentale (entre le Môle côtier et le Bloc de Zaer – Oulmès) a été ouverte au Famennien supérieur, lors d’une extension E-W.
2- Répartition spatiale des granitoïdes de la ZRT
Les granitoïdes de la ZRT affleurent dans la ZCNM où ils sont disloqués et dispersés tectoniquement (lentilles de différente taille) où ils font partie du mélange chaotique de nature purement tectonique. Néanmoins, la conclusion sur leur répartition spatiale en fonction de leurs âges (granites de Rabat d’âge 367 Ma, et ceux de Tiflet d’âge 605 – 609 Ma) ne peut être validée et corroborée qu’en datant les granitoïdes de Bled Msellat et ceux de l’Oued Grou..
3- Relation entre le « Corridor » de Bou Regreg et l’unité chaotique
Le cachet syntectonique compressif de la présumée «formation» chaotique dans un contexte collisionnel, ainsi que le passage progressif de celle-ci aux dépôts du BSB après que les auteurs aient pris le soin de supprimer la FOM (sur la Fig.1B) sont deux faits nouveaux qui vont à l’encontre de ce qu’a été unanimement admis jusqu’à nos jours, notamment le contexte tectonique distensif de la marge nord du BSB, depuis sa création jusqu’au début de sa structuration, postérieurement au Viséen. Précisons par ailleurs que les chevauchements du BS vers le sud à la fin du Dévonien sont totalement oblitérés au niveau de la ZCNM, ils ne sont reconnaissables et observables qu’au nord de celle-ci, notamment au SE de Rabat.
4- La collision du BS avec le nord de la MO
L’ouverture du « BSB » et des autres bassins de la MO est considérée comme s’étant produite sous l’effet d’un serrage dirigé ENE-WSW, vers la fin du Dévonien (Piqué, 1979; Simancas et al, 2009 et cet article). Il devient alors très difficile d’admettre que ces mêmes modalités géodynamiques vont ouvrir le BSB dans un contexte de « collision » continental entre le BS et le nord de la Meseta (comme cela est précisé dans la légende de la Fig.9 de l’article). La collision du BS avec le nord de la MO doit s’exprimer autrement que l’ouverture d’un bassin, ou bien par la création d’un bassin orogénique d’avant pays que les données de terrain doivent étayer. Or, à l’état actuel des données, aucun argument fiable de terrain ne corrobore l’existence d’un tel type de bassin.
Les données récentes de terrain (Lakhloufi, 2007) montrent bien que la partie E-W du « BSB » située entre le BS au nord et le Bloc de Zaer – Oulmès au sud, que nous avons dénommé Bassin de Brachwa-Maaziz (BBM), ne s’est ouverte que postérieurement au Viséen inférieur, sous l’action d’une distension subméridienne. Par ailleurs, lors du chevauchement du BS vers le sud, vers la fin du Dévonien, seule la patie ouest du « BSB » qui longe le Môle côtier a été ouverte au Famennien supérieur sous l’effet d’une distension sub E-W; c’est ce que nous avons dénommé le BSB s.s (sens strict). D’ailleurs, selon Piqué (1979 – 1994), El Hassani (1990), Tahiri (1991), Hoepffner et al (2005), le « BSB » a été déformé et structuré postérieurement au Viséen sous l’effet du poinçonnement par le BS qui aurait chevauché vers le sud; il ne serait donc pas possible que les modalités géodynamiques qui l’ont structuré (collision) sont celles qui ont causé son ouverture à la fin du Dévonien.
5- Signification géodynamique du Contact du BS avec la MO
Pour les auteurs dans l’article objet du commentaire, le BS chevauche vers le sud à la fin du Dévonien et entre en collision avec le nord de la MM. Ils pensent que cette limite pourrait correspondre à une suture majeure du Rheïque; néanmoins cela n’apparait pas sur la Fig.10. A, où on voit que le BS coulisse en dextre par rapport à la MM. Par contre, ce n’est qu’au Carbonifère tardif (Fig. 10. B) que le BS chevauche vers le sud; la ZRT pourrait être l’expression tardif de la principale suture hercynienne. Ces schémas n’apportent rien de nouveau par rapport aux Fig.6, B et D de Simancas et al. (2009), alors qu’il était opportun que le chevauchement du BS vers le sud et sa collision avec le nord de la MM doivent apparaitre sur la Fig. 10.A. accompagné des modifications de la paléogéographie globale qui s’imposent pour cette époque. Par ailleurs, ces nouvelles données (chevauchement du BS vers le sud et sa collision avec le nord de la MM) font que la Fig. 10. A, soit identique à la Fig. 10. B; or, si les données récentes (Lakhloufi, 2007) avaient été prises en considération, on aurait le BS qui chevauche vers le sud au Dévonien tardif – début Carbonifère, alors qu’il coulisse en dextre au Carbonifère supérieur; on aurait donc l’inverse des reconstitutions paléographiques globales proposés dans l’article.
Par ailleurs, nous précisons que l’état d’affleurement du chevauchement du BS vers le sud à la fin du Dévonien (de manière local dans la région de Rabat, au nord de la ZCNM) ne permet pas d’estimer l’importance de cet événement tectonique et donc sa place dans l’histoire géodynamique de la fermeture du Rhéïque. D’autre part, tout en étant en accord avec le fait que la ZRT représente l’expression tardif d’une suture hercynienne principale, il est impératif de souligner qu’elle s’est comportée comme une zone de cisaillement coulissante dextre fortement pentée vers le sud (vergence nord) et non comme zone de chevauchement de vergence sud.
Conclusion
Nous avions mis en évidence le chevauchement anté-carbonifère du BS vers le sud, événement que la datation radiométrique des granodiorites de Rabat à 367 Ma (fin du Dévonien) corrobore. Aussi, la “collision” du BS avec le nord de la MM est corroboré par nos données de terrains qui montrent que la partie E-W du « BSB » que nous avons dénommée BBM (située entre le BS au nord et le Bloc de Zaer – Oulmès au sud) ne s’est ouverte qu’au Viséen moyen. Ces faits confirment alors l’absence démontrée d’une «formation chaotique» au niveau de la ZRT.
Par ailleurs, il serait peu concevable que les granodiorites d’âge 605 – 609 Ma seuls témoignent de la présence d’un socle protérozoïque que surmontent des terrains ordoviciens. Nous avons montré que ces granitoïdes (indépendamment de leur âge) affleurent au sein de la ZCNM, où ils côtoient tectoniquement des roches sédimentaires allant du Cambrien moyen (BS) au Viséen supérieur et des roches basiques (d’âge ordovicien). Ce mélange tectonique de terrains de nature et d’âge très variés résulte d’un coulissage dextre majeur à composante inverse de vergence nord d’âge post viséen. C’est dans cette logique et celle du chevauchement fini Dévonien du BS vers le sud qu’il faut chercher l’explication de la présence des granodiorites du Protérozoïque tardif. Enfin, le modèle de Simancas et al (2009) doit être révisé à la lumière de nos récentes données et en tenant compte du chevauchement du BS vers le sud vers la fin du Dévonien daté relativement et radio-métriquement.
Références bibliographiques
Bouabdelli, M., Piqué, A., 1996. Du bassin sur décrochement au bassin d’avant pays : dynamique du bassin d’Azrou – Khénifra (Maroc hercynien central). J. Afr. Earth Sci. 22, 213-224.
Cailleux, Y., Deloche, Ch., Gonord , H. et Rolin, P. (1984) : Mise en évidence de deux couloirs de cisaillement dans la zone paléozoïque de Rabat – Tiflet (Maroc nord). C. R. Acad. Sci., Paris, 299, II. Pp. 569 – 572.
El Hassani, A., 1991. La zone de Rabat – Tiflet. Bordure Nord de la chaîne calédono – hercynienne du Maroc. Bull. Inst. Sci. Rabat. 15, 1-134.
El Hassani, A., Zahraoui, M., 1989. Le Paléozoïque de la région de Rabat (Maroc) : structures hercyniennes tangentielles, âge des déformations superposées et mise en place de nappes. Notes et Mém. Serv. géol. Maroc, n° 335. pp.211-219.
Hamel, C., 1968. Etude géologique des sites de barrage des oueds Grou et Bou Regreg (région de Rabat). Rapp. Inédit, Div. Ressources en eau, Min. Trav. Publi. Et Comm., Rabat.
Hoepffner, ch., Soulaimani, A. et Piqué, A. (2005). The Moroccan Hercynides. J. Afr. Earth Sci. 43, 144 – 165.
Izart, A., Vieselet, J.L., 1988. Stratigraphie, sédimentologie et micropaléontologie des sédiments du Bassin de Sidi Bettache et ses bordures (Meseta marocaine nord occidentale) du Famennien au Viséen supérieur. Notes et Mém. Serv. géol. Maroc, 334, pp. 7-41.
LAKHLOUFI, A., HAMOUMI, N., SAQUAQUE, A., AARAB, A. et JERMOUNI, A. 2000. EL Magmatismo Basico en la Cuenca Fameno- Dinantiense de Sidi Bettache (Marruecos Hercinico Noroccidental) : Nuevos Datos. Geogaceta, 28.
Lakhloufi, A., Hammoumi, N., Saquaque, A., 2001. Vergence des structures varisques et modalités de la structuration du Bassin de Sidi Bettache (Maroc hercynien nord occidental) : implications géodynamiques. Bol. R. Soc. Esp. Hit. Nat. (Sec. Geol.), 96 (3-4), 17-28.
Lakhloufi, A., 2007. Les bassins famenno – dinantiens (Maroc) : nouvelle conception de la géodynamique hercynienne. Notes et Mém. Serv. Géol. Maroc, n° 526. 255 p.
Padgett, G., Ehrlich, R., Moody, M. 1977. Submarine debris flow deposit in extensional setting. Upper Devonian of western Morocco. J. Sedim. Petrol., 47, pp. 811-818.
Piqué, A., 1979. Evolution structurale d’un segment de la chaîne hercynienne : la Meseta marocaine nord – occidentale. Sci. Géol. Mém., Strasbourg, 56, 243p.
Piqué, A., 1984. Faciès sédimentaire et évolution d’un bassin : le bassin dévono – dinantien de Sidi Bettache (Maroc nord-ocidental). Bull. Soc. Géol. France 6, 1015-1024.
Piqué, A., 1994. Géologie du Maroc : les domaines régionaux et leur évolution structurale. 239p, édit. pumag, El Jadida, Maroc.
Simancas, J. F., Azor, A., Martines-Poyatos, D., Tahiri, A., El Hadi, H., Gonzalez-Lodeiro, F., Pérez-Estaun, A., et Carbonell, R. (2009). Tectonic relationships of southwest Iberian with the allochtons of Northwest Iberia and the Moroccan Variscides, C. R. Geoscience, doi: 10.101/j.crte.2008.11.003.