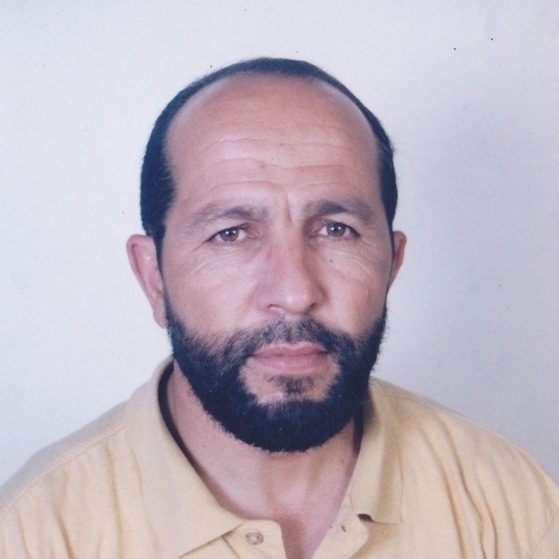Les investigations scientifiques poussées que nous avons menées dans le NW du Massif Hercynien Central Marocain (Meseta occidentale), pour la préparation d’une thèse de troisième cycle (soutenue en 1988) et une thèse d’Etat en Géologie Structurale (soutenue en 2002), nous ont amené à faire une révision profonde de plusieurs aspects de la géologie de l’orogenèse hercynienne marocaine ; cinq thèmes sont concernés par ces profondes révisions.
«Du point de vue lithostratigraphique, magmatique et paléogéographique, nous avons montré que le Bassin de sidi Bettache (Piqué, 1979 ; El Hassani, 1990 ; Tahiri, 1991 ; Fadli, 1991 ; Zahraoui, 1991) correspond en fait à deux bassins adjacents : – le Bassin de sidi Bettache s.s. [BSB s.s.], ouvert au Famennien supérieur, directement à l’E du Môle côtier (Meseta côtière), lors d’une extension E-W ; – le Bassin de Brachwa – Maaziz (BBM), ouvert au Viséen moyen, entre le Bloc de Sehoul au nord et le Bloc de Zaer – Oulmès au sud, lors d’une extension N-S.
Nous avons montré aussi, que le chevauchement du Bloc de Sehoul vers le sud, est scellé par les conglomérats du Viséen moyen (bloc dont la structuration est mise, auparavant, sur le compte de l’orogenèse calédonienne, alors que récemment, elle est mise sur le compte de la tectonique hercynienne précoce, comme dans la Meseta orientale). Ce chevauchement a eu lieu donc au Dévonien supérieur, fait qui est corroboré par l’ouverture du BBM qui n’avait eu lieu que tardivement, au Viséen moyen et non au Dévonien supérieur (Lakhloufi, 2002 ; 2007). Dans ce sens, nous avons également montré qu’au niveau de la Meseta occidentale, l’ouverture des bassins sédimentaires au Famennien supérieur a lieu uniquement au niveau du Môle côtier (Bassin de Safi) et directement à l’est de celui [Bassin de sidi Bettache s.s. au nord et Bassin de Foum El Mejez dans les Rehamna, au sud (El Kamel, 1987)]. Par ailleurs, nous avons montré aussi que là où sont ouverts les bassins au Famennien supérieur (Lakhloufi, 2007), les terrains sont hachés de fractures subméridiennes (notamment NNW – SSE et NW – SE). C’est cette organisation structural qui a été, donc, favorable à l’ouverture de ces bassins lors d’une extension sub E-W, concomitante au raccourcissement subméridien qui a fait chevaucher le Bloc de Sehoul vers le sud, au Dévonien supérieur (Lakhloufi, 2002 ; 2007). Fadli (1991) parle d’une double extension dans les régions de Khatouat et de Mdakra, faute de l’absence des terrains du Viséen moyen et Viséen supérieur qui permettent de distinguer entre la distension sub E-W, qui a eu lieu au Fammenien supérieur – Viséen inférieur et la distension nord-sud, qui a eu lieu au Viséen moyen – Viséen supérieur.
La question qui se pose alors, c’est comment concilier entre le raccourcissement sub E-W qui structure la Meseta orientale au Dévonien supérieur et le raccourcissement subméridien qui a fait chevaucher (ou structurer) le Bloc de Sehoul vers le sud et a causé l’ouverture du BSB s.s. et des bassins de Foum El Mejez et de Safi, tout à fait à l’ouest de la Meseta occidentale? Pour les différents auteurs (Piqué, 1979 ; Hoeppfnert, 1987 ; Bouabdelli , 1989 ; Tahiri, 1991), le raccourcissement sub E-W (ENE – WSW) qui structure la Meseta orientale est responsable de l’ouverture des bassins sédimentaires de type pull apart (Piqué, 1979) ou de type transtension – transpression (Bouabdelli, 1989), dans la Meseta occidentale.
Néanmoins, en disposant de quelques datations radiométriques, de certaines lentilles tectoniques de granites qui jalonnent la Zone de Cisaillement Nord Mesetienne (ZCNM) (cf. ci-dessous), Tahiri et al. (2010), ont opté pour un changement radical de la géodynamique hercynienne. Le contexte distensif de l’ouverture du Bassin de sidi Bettache, que Piqué (1979) a qualifiée de révolution famenienne ; contexte distensif que tous les auteurs hercynologues (hercynien marocain) ont adopté et ratifié, dont notamment El Hassani (1990), Tahiri (1991), Fadli (1991), Zahraoui (1991), Lakhloufi (2002) a brutalement laissé place à un bassin de type orogénique qui aurait pris naissance dans un régime compressif d’orogenèse, sans aucune trace d’un argument plausible dans ce sens. Sa marge nord serait caractérisée par une sédimentation de type front orogénique, au front du chevauchement du Bloc de Sehoul vers le sud, qui serait structuré à cette époque (Tahiri et al. 2010). Bien sûr, hormis l’âge de 367 Ma (sur zircon) de certaines lentilles tectoniques de granite (qui étaient datées, avant, à 420 Ma sur K/Ar) dispersées dans la ZCNM, aucune donnée de terrain ne peut corroborer cette volteface des idées. Mais ce qui est contrariant dans cette histoire, c’est que l’article de Tahiri (Tahiri et al., 2010) s’imposera alors dans la reconstitution des modalités géodynamiques de l’orogenèse hercynienne. En effet, Tahiri a opté pour un « putsch » dans la géodynamique hercynienne qui va à l’encontre des résultats de ses travaux (Tahiri, 1991) et de tous les autres travaux (Padgett et al, 1976 ; Piqué, 1979 ; Izart et Vieselet, 1989 ; El Hassani 1990 ; Lakhloufi, 2002, 2007.) ; résultats qui montrent que le BSB de Piqué (1979) a été ouvert dans un contexte distensif. Les failles normales, connues au niveau de sa marge nord, ont conduit à la formation d’une gouttière (graben), limitée par le Bloc de Sehoul qui la surplombe du côté nord et par la ride (horst) de Rabat – Tiflet de Piqué (1979) au sud.
Par ailleurs, Tahiri et al. (2010) n’ont pas jugé nécessaire de citer mes travaux parmi les références bibliographiques de leur article (comme tous les scientifiques qui se respectent), bien que les résultats de mes travaux (Lakhloufi, 2002 ; 2007) sont utilisés, d’une manière contournée, dans l’élaboration de leur modèle qui consiste à l’ouverture du BSB de Piqué (1979) au front d’un contexte orogénique compressif au nord. Par conséquent, ces auteurs (Tahiri et al. 2010) sont appelé à intégrer dans leur modèle orogénique de la fin du Dévonien (structuration du Bloc de Sehoul et son chevauchement vers le sud), les modalités de l’ouverture du Bassin de sidi Bettache de Piqué (idem), ainsi que les modalités de la structuration de la Meseta orientale par un raccourcissement sub E-W. En dehors des âges 367 Ma et 605 Ma, comme nouvelle donnée, qui sont les âges de certaines des lentilles granitiques qui jalonnent la ZCNM, l’article de Tahiri et al. (2010), a donc posé des problèmes géologiques insolvables, relatifs à l’orogenèse hercynienne au niveau du Maroc, et ailleurs, comme conséquence.
Thème 1 : Lithostratigraphie
En nous basant sur les implications structurales et sur la chronologie relative des roches, de leurs constituants, des événements et phénomènes géologiques, nous avons pu établir un certain nombre de faits, dont notamment deux qui ont des implications structurales et géodynamiques profondes.
La non existence de formation chaotique faméno-tournaisienne
La non existence d’une formation chaotique d’âge famenno-tournaisien jalonnant la marge nord du BSB et la limite sud du Bloc de Sehoul ; l’aspect chaotique de ces terrains est d’origine purement tectonique, au sein d’une importante et large zone de cisaillement, qui est la Zone de Cisaillement Nord Mesetienne (cf. ci-après).
Age viséen moyen des conglomérats au niveau de la limite nord du BBM
L’attribution d’un âge viséen moyen – viséen supérieur certain aux conglomérats qui jalonnent la bordure nord du BBM, dont le célèbre « Poudingue siliceux » et les «Conglomérats calcaires» (Piqué, 1979 ; El Hassani, 1990). En effet, ce dernier faciès remanie les fameuses « nodules ferrugineuses » qui sont typiques de la Formation de Korifla (BSB s.s.) d’âge tournaisien – viséen inférieur. Il s’agit donc d’un argument indiscutable qui prouve que le BBM n’a été ouvert qu’au Viséen moyen, et non au Dévonien supérieur, comme le prétendent Tahiri et al. (2010). Par conséquent, le modèle présumé de l’ouverture du Bassin de sidi Bettache de Piqué (1079), en tant que bassin orogénique (Tahiri et al., 2010), au front d’un présumé charriage du Bloc de Sehoul vers le sud, au Dévonien supérieur, est donc caduque.
Thème 2 : Tectonique synsédimentaire
Mise en évidence d’une inédite tectonique compressive synsédimentaire, d’âge viséen moyen – viséen supérieur, dans le BSB s.s., qui a été ouvert au Famennien supérieur. Cette tectonique s’exprime essentiellement sous forme de rampes à l’échelle des bancs gréseux et de l’affleurement. Des plis NNW-SSE et des failles inverses sont également observés. Par contre, cette tectonique compressive est absente dans le BBM [partie orientale du BSB de Piqué (1979)] qui s’est ouvert au Viséen moyen. Il s’agit, là aussi, d’arguments tangibles en faveur de l’inversion du champ de contraintes à partir du Viséen moyen ; inversion qui a été favorable à l’ouverture du BBM entre le Bloc de Sehoul au nord et le Bloc de Zaer – Oulmès au sud, sous l’effet d’une extension subméridienne, alors que le BSB s.s. a été comprimé sub E-W sans qu’il soit entièrement fermé.
Thème 3 : Magmatisme basique
L’apport principal relatif au magmatisme basique dans la région d’étude est notamment d’ordre structural ; plusieurs faits sont alors établis, ainsi, du point de vue cartographique, on retient que :
– les roches basiques se rencontrent uniquement dans le BSB s.s. qui a été ouvert au Famennien supérieur ;
– leur répartition spatiale au sein du BSB s.s. n’est pas tributaire de ses marges, comme cela a été admis jusqu’alors (Piqué, 1079) ; elles sont, plutôt associées à des failles NNW-SSE à NW- SE qui hachent ce bassin ;
– mise en évidence d’un alignement majeur de roches basiques («Alignement Akrech – Tsili ») au sein duquel elles peuvent être largement grenue (notamment texture doléritique) et développent un large auréole de métamorphisme de contact hydrothermal à Cordiérite et Andalousite (Chiastolite) ;
– les roches basiques d’âge famenno -viséen inférieur apparaissent de plus en plus jeunes d’W en E; tout à fait à l’E, elles sont exceptionnellement d’âge viséen moyen (base du Viséen moyen, âge d’ouverture du BBM) dans une large faille ENE – WSW (Faille d’Al Mchat), directement au sud de la ZCNM, sur laquelle elle vient se raccorder;
– deux alignements de roches basiques sont à exclure du paysage magmatique tournaisien – viséen inférieur du BSB s.s. : – l’alignement NNW-SSE de l’oued Khellata qui est d’âge permien (Bandet et al., 1990) ; – l’alignement WNW-ESE de la rive droite de l’oued Grou d’âge qui est plutôt de l’Ordovicien.
Le caractère géochimique des roches basiques dans ces deux derniers alignements ne doit donc pas être pris en considération dans la recherche des modalités géodynamiques de l’ouverture du BSB s.s. et du BBM.
Thème 4 : Paléogéographie
Les apports relatifs à ce thème sont abordés à deux échelles différentes:
+ A l’échelle du BSB de Piqué (1979)
Nous avons démontré que ce bassin s’est ouvert en deux temps et se compose, donc, de deux bassins sub-indépendants l’un de l’autre ; le Bassin de sidi Bettache sens strict (le BSB s.s.) à l’W et le Bassin de Brachwa – Maâziz (BBM) à l’E.
Le Bassin de sidi Bettache sens strict (BSB s.s.)
Le BSB s.s. s’est ouvert entre le Môle côtier à l’W et le Bloc de Zaer – Oulmés à l’E. Il a été initié au Famennien supérieur et a fonctionné jusqu’au Viséen inférieur. La distension sub E-W à l’origine de son ouverture a été guidée par le dense réseau des failles NNW –SSE à NW-SE qui hachent son substratum, avec une migration du dépocentre de l’W vers l’E, alors qu’au Viséen moyen – Viséen supérieur, il a été comprimé sub E-W, sans qu’il soit fermé. L’activité magmatisme basique qui a eu lieu dans ce bassin prouve que ces failles étaient profondément enracinées et que l’extension sub E-W était importante.
Le Bassin de Brachwa – Maâziz (BBM)
Le BBM s’est ouvert entre le Bloc de Sehoul au N et le Bloc de Zaer – Oulmès au S. Il a été initié au Viséen moyen, sous l’effet d’une distension subméridienne qui a été guidée par les failles sub E-W qui marquent ce bassin. Cette distension est moins importante que celle qu’a connue le BSB s.s, ouvert antérieurement, comme en témoigne l’absence de magmatisme basique dans le BBM ; les failles sub E-W ne sont donc pas profondément enracinées et la distension est peu importante.
+ A l’échelle de la Meseta occidentale
Au Famennien, les bassins se sont ouverts de part et d’autre de la Zone de Cisaillement Ouest Mesetienne (ZCOM), ou West Mesetian Shear Zone (WMSZ). Le Bassin de Safi, connu par forage, s’est ouvert au niveau du Môle côtier (Meseta côtière), à l’W de la ZCOM, où il a fonctionné uniquement durant le Famennien. Directement à l’E de la ZCOM, le Bassin de sidi Bettache s.s. s’est ouvert au nord et le Bassin de Foum El Mejez ouvert au sud, dans les Rehamna. Par ailleurs, les bassins d’Azrou – Khenifra et de Tiliouine (Massif hercynien central marocain) ne s’ouvriront franchement que postérieurement au Viséen inférieur, au cours du Viséen moyen.
Thème 5 : Tectonique et évolution structurale
Du point de vue tectonique et structural, nous avons pu mettre en évidence plusieurs faits, aussi bien à l’échelle du NW de la Meseta occidentale (domaine de nos investigations), qu’à l’échelle des domaines mesetien et de anti-atlasique (domaines des corrélations).
Linéaments tectoniques et zones de cisaillement
Nous avons montré que le BSB s.s. et le BBM sont limités au nord par une faille majeure, d’ampleur crustale, de direction sub E-W, d’affleurement limité (à peu près 60 km), entre Rabat à l’W et Tiflet à l’E. Cette faille est omniprésente dans l’évolution paléogéographique et structurale du domaine mesetien, durant le Paléozoïque (Lakhloufi, 2002, 2007), voire ultérieurement, jusqu’au Quaternaire (néotectonique). Postérieurement au Viséen supérieur, lors de la première phase de déformation qui a affecté l’ensemble des domaines mesetien et anti-atlasique (cf. ci-dessous), elle s’est comportée comme une mégazone de cisaillement dextre [la Zone de Cisaillement Nord Mesetienne (ZCNM) ou North Mesetian Shear Zone (NMSZ)] de vergence vers le nord, fortement inclinée vers le sud, d’un rejet minimal de plus de 30 km ; son affleurement limité ne permet pas l’estimation exact de son rejet. Ce coulissage dextre est responsable d’une mylonitisation et d’un découpage lenticulaire généralisé des terrains paléozoïques, à toutes les échelles d’observation, donnant lieu à un mélange chaotique de cachet purement tectonique, qui a été considéré comme formation chaotique sédimentaire (Piqué, 1979 ; El Hassani, 1990 ; Tahiri et al., 2010).
Par ailleurs, le BSB s.s. est haché de fractures, notamment NNW-SSE et NW-SE qui ont contrôlé son ouverture (au Famennien), la mise en place de magmatisme basique, lors d’une extension E- W (Fadli, 1991 ; Lakhloufi, 2002). Ultérieurement, ils ont contrôlé sa structuration lors des deux phases de déformation majeures (cf. ci-dessous). Par contre, les failles sub E-W (notamment des ENE-WSW) qui ont contribué à l’ouverture du BBM au Viséen moyen sont «sèches» du point de vue activité magmatique, sauf très localement (cf. ci-dessus).
Les phases tectoniques (les phases de plissement)
Postérieurement au Viséen, les terrains du BSB s.s. et du BBM ont enregistré trois phases de déformation, d’importance inégale, spatialement et temporellement.
La première phase tectonique (plissement P1)
La première phase tectonique post-viséenne a engendré des plis P1 sub E-W (ENE – WSW) de vergence vers le NNW (sauf localement, cf. ci-dessous), synschisteux ou non, qui ont imposé les traits structuraux majeurs des terrains du BBM qui sont armés de puissantes barres gréseuses et gréso-quartzitiques du Viséen moyen – Viséen supérieur. Cependant, au niveau du BBS s.s., où les terrains gréso-pélitiques sont peu armés de barres gréseuses, les plis P1ont été sérieusement brouillés par la vigoureuse reprise par les plis P2 et les jeux décrochants des accidents NNW – SSE et NW – SE (méga-crochons). Cette première phase tectonique post-viséenne comporte deux épisodes de déformation, montrant que le serrage est passé de la direction NNW – SSE à NE – SW, suite à une rotation antihoraire des contraintes. Au niveau de la ZCNM, les plis P1 de vergence vers le NNW, qui ont pris naissance pendant le premier épisode de déformation, ont été dilacéré lors du deuxième épisode qui est responsable du coulissage dextre majeur de cette zone.
La seconde phase de déformation (plissement P2)
La seconde phase de plissement a engendré des plis P2 subméridiens, NNW-SSE à N-S, généralement synschisteux, notamment au niveau BSB s.s., où ils imposent les traits structuraux majeurs des terrains, tout en oblitérant sérieusement les traits structuraux sub E-W. Ce fait a été favorisé aussi par les réorientations spectaculaires causées par les méga-crochons du jeu senestre (essentiellement) des failles NNW – SSE à NE – SW, lors de deuxième épisode de déformation de la première phase tectonique. Cependant, au niveau de toute la partie orientale du BBM, les P2 ne sont que sporadiques, bien exprimés localement au sein de couloirs de cisaillement subméridiens de largeur pluri-décamétrique à pluri-hectométrique. Par ailleurs, sur le plan de la chronologie relative, les plis P2 replissent les lentilles tectoniques de la ZCNM (ou la NMSZ).
Sur un autre plan, le schéma structural de Fadli (1991) montre, indiscutablement, que les dites « virgations » qui reprennent les plis dans les régions de Khatouat et de Mdakra correspondent à de vigoureux plis P2, subméridiens, qui replissent des plis P1 sub E-W. A lui seul, le schéma structural de Fadli (idem) constitue la preuve tangible de l’existence de deux phases majeures de plissement post-viséennes. Néanmoins, l’auteur ne reconnait pas ce fait structural, afin de rester, peut-être, aligné sur le modèle du maître Piqué qui est devenu le modèle français sacré de l’orogenèse hercynienne marocaine. Enfin, la deuxième phase de déformation s’est déroulée elle-même en deux épisodes ; le serrage est passé d’ENE – WSW (épisode 1) à ESE-WNW (épisode 2), suite à une rotation horaire des contraintes.
La troisième phase de déformation (plis P3)
La troisième phase de déformation engendre des plis P3 de direction sub E-W, d’importance moindre, qui ne s’expriment de manière spectaculaire qu’au niveau du BSB s.s., de plus en plus en direction de sa marge ouest, où ils sont localement bien développés et éventuellement synschisteux. Néanmoins, il se peut que l’absence des P3 au niveau du BBM est due au fait qu’ils sont coaxiaux aux plis P1 qui imposent les traits structuraux majeurs dans ces régions où les terrains sont armés de grosses barres gréseuses du Viséen moyen et du Viséen supérieur.
La vergence des structures
La vergence des structures tectoniques constitue un critère structural très important, permettant de préciser les modalités de la structuration d’une région donnée et les causes du serrage qui en est responsable. Ainsi, la vergence des structures issues de la première phase de déformation qui est vers le NNW au niveau du BBM est due au poinçonnement de celui-ci par le Bloc de Zaer – Oulmès. La vergence locale des plis P1 vers le SSE, au niveau d’une bande large de quelques kilomètres, directement au nord du Bloc de Zaer – Oulmès est en faveur d’un sous-charriage de celui-ci vers le nord, tout en opérant une rotation antihoraire ver le NW. Ce sous-charriage rotationnel anti-horaire est attesté par le déversement structural de plus en plus important d’W en E, au niveau de la bordure sud du BBM. C’est d’ailleurs ce fait qui explique la vergence vers le nord de la ZCNM, qui est fortement inclinée vers le sud. Par ailleurs, la vergence vers le sud, relevée au niveau de cette mégazone de cisaillement est de cachet secondaire, local ; elle est tributaire d’un réseau d’accidents N110 – N120 néoformés, dextres à composante inverse de vergence vers le SSW, de rejet d’ordre métrique à hectométrique. Ce réseau d’accidents est relativement bien développé localement, sur le versant droit de la vallée de l’oued Grou. Ainsi donc, l’idée du poinçonnement du BSB par le Bloc de Sehoul (Piqué ; 1979 ; El Hassani, 1990 ; Tahiri et al., 2010) est désormais caduque. Néanmoins, le fait que cette idée reste incontournable dans la recherche des modalités de la structuration de la région et du domaine hercynien, que proposent les différents auteurs trouve, peut-être, sa légitimité dans son ancienneté !!! (Piqué, 1979) et le grand nombre de géologues qu’y adhèrent; vive la démocratie scientifique.
Dans le cas des structures tectoniques subméridiennes, engendrées par la deuxième phase de déformation, la vergence est soit vers l’E soit vers l’W (notamment dans le cas des failles). Cette double vergence est bien accusée dans la région de Khatouat où les plis P1, d’échelle cartographique, sont repris vigoureusement par des plis P2, également d’échelle cartographique. Ce fait est très bien illustré par le schéma structural de Fadli (1991) qui n’a, apparemment pas voulu se démarquer de la caravane des géologues qui sont restés fidèles aux idées préconçues de Piqué (1979). L’apport le plus spectaculaire du travail de Fadli (idem) étant cet argument plausible en faveur d’une vigoureuse deuxième phase de plissement ; néanmoins il a, de toute évidence, préféré ne pas attirer la foudre de son ex-encadrant (patron !!) et de l’Ecole française.
Corrélations et extrapolations
Du point de vue corrélation et extrapolation avec les domaines structuraux voisins, nous retenons que :
– le Bloc de Zaer – Oulmès enregistre les deux premières phases de plissement (les plis P2 sont amples…), antérieurement à la mise en place du granite de Zaer au Westphalien terminal (303Ma) ; fait permettant de caler les deux premières phases de déformation par rapport à cet âge absolu, plafond;
– le Môle côtier n’a été structuré que lors de la deuxième phase de plissement qui a donné naissance aux plis P2 NNW –SSE ; les plis P1 sont absents.
Du point de vue corrélation avec le domaine hercynien marocain (la Meseta occidentale, la Meseta orientale et l’Anti- Atlas), on note:
– la première phase de plissement post-viséenne, au niveau du BBM et du BSB s.s. a affecté l’ensemble des domaines mesetien et anti- atlasique, à l’exception de l’extrême ouest du domaine hercynien où le Môle côtier et l’Anti-Atlas allochtone qui sont structurés par les plis méridiens à subméridiens, tributaires de la deuxième phase de déformation (plis P2).
Par ailleurs, le fait que la première phase de déformation soit plus intense au niveau de la Meseta orientale (socle déjà structuré lors de la phase bretonne, à la fin du Dévonien), avec des plis synschisteux et un métamorphisme épizonal, notamment à l’approche de la limite avec l’Anti-Atlas oriental au sud, constitue un argument en faveur du poinçonnement du domaine mesetien par le Craton West Africain (CWA) et sa marge nord, l’Anti-Atlas, qui est sub-cratonisé (orogenèse panafricaine). Le WAC parait avoir effectué une rotation antihoraire vers le NNW, à l’image du Bloc de Zaer-Oulmès, au niveau de la Meseta nord occidentale, qui a poinçonné le BBM vers le nord, également suite à une rotation antihoraire ; portrait-robot rendant compte des modalités de la structuration hercynienne des domaines mesetien et anti-atlasique lors de la première phase de déformation post – viséenne.
– la seconde phase de déformation a affecté l’extrême ouest des domaines mesetien (Môle côtier ou Meseta côtière) et anti-atlasique (Anti – Atlas allochtone) et une plus ou moins large bande, directement à l’E, où interfèrent les plis P1 et les plis P2. Cette bande se continue depuis le BSB s.s. au nord (NW de la Meseta occidentale), à l’E de La ZCWM, jusqu’à la région de Tata (Anti-Atlas occidental ; obs. pers) ; en passant par les Rehamna (El Kamel, 1987), les Jbilet et le Haut-Atlas occidental (Aarab, 2004). Ainsi, la deuxième phase de déformation qui affecte, exclusivement, le Môle côtier et l’Anti-Atlas allochone est à relier à l’orogenèse des Mauritanides, plus au sud, où les directions structurales méridiennes à sub-méridiennes épousent la limite ouest du CWA.
Ainsi donc, les traits structuraux du domaine hercynien marocain (Meseta et Anti – Atlas), situé entre le « Craton West Africain » (CWA) au sud et le « North Americain Craton » (NAC) ou la Laurentia, à l’W, ont été dicté par les directions des limites de ces deux cratons. Les directions structurales sub E –W, dominantes dans le domaine mesetien à l’E du Môle côtier sont dictées par la limite nord du CWA. Les directions subméridiennes (notamment NNW-SSE) exclusives au niveau du Môle côtier et de l’Anti – Atlas allochtone (tout à fait occidental) sont dictées par la limite W du CWA et celle E de la Laurentia (NAC). Le CWA parait donc avoir joué un rôle déterminant dans la structuration hercynienne du domaine mesetien marocain et celui anti-atlasique, postérieurement au Viséen (en dehors du Môle côtier et de l’Anti – Atlas allochtone).
Lors de la première phase de déformation, le Maroc hercynien a, principalement, coulissé en dextre par rapport au domaine orogénique hercynien de l’Europe occidentale, au nord, sous l’effet de la poussée rotationnelle antihoraire du CWA vers le NW (Lakhloufi, 2002 et 2007). Un tel coulissement est illustré par le jeu dextre de la ZCNM (NMSZ), fortement pentée vers le sud ; alors qu’à la fin du Dévonien, cette zone a connu un large chevauchement du Bloc des Sehoul vers le sud.
Par ailleurs, lors de la seconde phase de structuration post-viséenne, la bande littorale des domaines mesetien et anti-atlasique a été comprimé E-W à l’image des Mauritanides au sud, sous l’effet de la poussée relative du CWA et de sa marge nord dans la direction NAC.
Références bibliographiques (celles citées et d’autres pour plus d’information)
AARAB A. (1988)- Etude géologique de la région de l’Ounein (Haut – Atlas occidental. Thèse 3ème cycle E.N.S Rabat, pp. 165, 1 cart. ht…
BANDET Y., GONORD H., CAILLEUX Y., DELOCHE Ch. et ZOUINE E.M (1990)- Age K-Ar triasique des vulcanites des Beni Abid (Bassin dévono – dinantien de Sidi Bettache, Meseta marocaine nord occidentale). C. R. Acad. Sci, t. 310, série II, Paris, p. 1665-1671..
BOUABDELLI M. (1989)- Tectonique et sédimentation dans les bassins orogéniques : le sillon viséen d’Azrou – Khenifra (Est du massif hercynien central). Thèse Es Sciences, U.L.P. Strasbourg, 257P.
CAILLEUX Y., DELOCHE Ch, GONORD H. et ROLIN. P (1984) – Mise en évidence de deux couloirs de cisaillement dans la zone paléozoïque de Rabat- Tiflet (Maroc septentrional). C. R. Acad. Sci., Paris, 299, II. p. 569-572.
DANZE-CORSIN P. (196l) – Note sur une flore du Carbonifère inférieur de l’oued Korifla (région sud de Rabat). Notes Serv. Géol. Maroc, 20, 152, p. 81 – 125.
EL HASSANI A. et ZAHRAOUI M. (1989) – Le Paléozoïque de la région de Rabat (Maroc) ; Structures hercyniennes tangentielles, âge des déformations superposées et mise en place des nappes. Notes et M. Serv. Géol. Maroc, Rabat, n° 335, pp. 211-219, 4 fig.
EL HASSANI A. (1990) – La bordure nord de la chaîne hercynienne du Maroc. Chaîne » calédonienne » des Sehoul et plate-forme nord mesetienne. Thèse Es Sciences, Univ. L. Pasteur, Strasbourg, 208p.
EL KAMEL F. (1987)- Géologie du Paléozoïque des Rehamna nord orientaux, Maroc. Evolution sédimentaire et structuration hercynienne d’un bassin dévono – carbonifère. Sédimentation et déformation des molasses post-orogéniques. Thèse 3ème cycle. Univ. Aix-Marseille, 298p.
FADLI D. (1990) – Evolution sédimentaire et structurale des massifs des Mdakra et du Khatouat ; deux segments hercyniens de la Meseta marocaine nord-occidentale. Thèse Es Sciences, Rabat, 272p.
HASSENFORDER B. (1987)- La tectonique panafricaine et varisque de l’Anti -Atlas dans le massif de Kerdous (Maroc). Thèse Sci., Univ. L. Pasteur, Strasbourg, 249p.
HOEPFFNER Ch. (1987)- La tectonique hercynienne dans l’Est du Maroc. Thèse Sci., Univ. L. Pasteur, Strasbourg, 276.
IZART A. (1990) – Dynamique des corps sédimentaires clastiques des bassins carbonifères de la Meseta marocaine. Thèse Sciences, Univ. Dijon, 356p.
LAAMRANI ELIDRISSI A. (1993) – Relations déformations- déplacement le long de failles hercyniennes : système de Bouznika et systèmes de Cherrat – Ben Slimane et du Cherrat – Yquem. Thèse de 3ème cycle, Univ. Mohamed V, 212p.
LAKHLOUFI A., DELOCHE Ch., GONODRD H., LOPEZ M. et ZOUINE EM. (1987) – Nouvelles données structurales dans la région centrale du Bassin dévono-dinantien de Sidi Bettache (Meseta hercynienne septentrionale, Maroc). 112e Congrès national des Sociétés Savantes, Lyon, IIème Colloque Géologie africaine, p. 35-44.
LAKHLOUFI A. (1988)- Etude structurale de la région de Brachwa. Parties centrale et nord – orientale du Bassin dévono-dinantien de Sidi Bettache (Maroc nord occidental). Thèse de 3ème cycle, ENS – Rabat, 281p.
LAKHLOUFI A. (1992)- Mise en évidence d’un maillage de fractures précoces dans le Bassin de Sidi Bettache ; son rôle dans l’évolution post-dévonienne du Maroc hercynien nord occidental (note présentée lors du colloque géologique international, Rabat, 1990 : » Maroc, promontoire africain entre la Méditerranée et l’Atlantique »). Notes et M. serv. géol. Maroc, Rabat, n° 336, pp.323-341.
LAKHLOUFI A., HAMOUMI N., SAQUAQUE A., AARAB A. et JERMOUNI A. (2000) – EL Magmatismo Basico en la Cuenca Fameno- Dinantiense de Sidi Bettache (Marruecos Hercinico Noroccidental) : Nuevos Datos. Geogaceta, 28.
LAKHLOUFI A., HAMOUMI N. et SAQUAQUE A. (200l)- Vergence des structures varisques et modalités de la structuration du Bassin de Sidi Bettache (Maroc hercynien nord occidental): Implications géodynamiques. Bol. R. Soc. Esp. Hit. Nat. (Sec. Geol.), 96 (3-4).
LAKHLOUFI A., HAMOUMI N. et SAQUAQUE A. (à paraître)- Mise en évidence d’une tectonique compressive synsédimentaire intra-viséen supérieur dans le Bassin famenno-dinantien de Sidi Bettache (Meseta occidentale septentrionale, Maroc). Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol).
LECORCHE J.P. et SOUGY J. (1978) – Les Mauritanides, Afrique occidentale. Essai de synthèse. In TOZER E.T SCHENK P.E (eds): Caledonian-Appalach orogen of the North atlantic region. Geol. Surv. Can. Pap 78-13: p. 231-239
LECORCHE J.P., BRONNER G., DALLMEYER R.D., ROCCI G. et ROUSSEL J. (1991) -The Mauritanide orogen and its northern extensions (Western Sahara and Zemmour), West Africa.. In: R.D. Dallmeyer et J.P. Lécorché (eds), The West Africa orogens and circum-atlantic correlatives, Springer Verlag, 187-227.
LEFORT J.P. (1989) – La rotation du Gondwana Land et ses effets dans les Maritimes et au Maroc au Dévono-Carbonifère. Notes et M. Sen, géol. Maroc, Rabat, n° 335, pp. 329-336, 4 figs.
MATTE P. (1986) – La chaîne varisque parmi les chaînes paléozoïques péri-atlantiques, modèle d’évolution et position des grands blocs continentaux au Permo – Carbonifère. Bull. Soc. géol. France, n° 1, p. 9- 24.
MICHARD A., CAILLEUX Y. et HOEPFFNER Ch (1983)- l’orogène mesetien au Maroc ; structure, déformation hercynienne et déplacements. Actes du Symposium » Maroc et orogenèse paléozoïque », P.I.C.G. n° 27, Rabat, 1983. Notes et Mém. Serv. géol., Maroc , n° 335 (1989), pp. 313-328).
MICHARD A. et PIQUE A. (1981)- Les zones structurales du Maroc hercynien. Sci. géol., Strasbourg, Fr., t. 34, n° 2, p, 135-146.
MILLIES-LA-CROIX A. (1974)- Carte géotechnique de la région de Rabat au 1/50.000. Notes et Mém. Serv. géol. Maroc, 238. .
MORIN Ph (1973) – L’accident de Bsabis – Tazekka, un linéament majeur de la tectonique hercynienne du Maroc (Ouest de Taza). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 2, pp. 64-67.
PADGETT G., EHRLICH R. et MOODY M. (1 977) – Submarine debris flow deposits in an extensional setting. Upper Devonian of western Morocco. J. Sedim. Petrol., 47, p : 811-818.
PIQUE A. (1979) – Evolution structurale d’un segment de la chaîne hercynienne – la Meseta marocaine nord occidentale. Thèse ès Science, U.L.P. Strasbourg, 253p.
PIQUE A. (1982)- La zone de Rabat-Tiflet (Meseta marocaine septentrionale). Sa place dans l’ensemble des noyaux paléozoïques de la Méditerranée. C. R .Acad. Sci. Paris, 295, 11, pp : 263-266.
PIQUE A. (1984) – Faciès sédimentaire et évolution d’un bassin : le bassin dévono-dinantien de Sidi Bettache (Maroc nord occidental). Bull. Soc. géol. France, 26, p. 1015-1023.
PIQUE A. (1987)- Un élément majeur de la Meseta marocaine nord -occidentale : le bassin dévono-dinantien de Sidi Bettache. Notes et Mém. Serv. géol. Maroc., t. 43, 321, pp. 41-64.
PIQUE A. et SKEHAN J.W. (1992) – Late Paleozoic orogenies in western Africa and eastern North America: the diachronous closure of the Theic Ocean. Tectonic, 11, p. 392-404.
ROLIN P., CAILLEUX Y., DELOCHE Ch. et GONORD H. (1985). Décrochements fini dévoniens et ouverture de bassins de type pull apart ; deux exemples comparés : les Bassins de Sidi Bettache (Maroc septentrional) et de Châteaulin (Bretagne Occidentale, France). 110ème Cong. National des soc. sav. fasc VI, p. 67-77
ROUSSEL J., LECORCHE J.P., PONSARD J.F., SOUGY J. et VILLENEUVE M. (1984) – Panafricain to Hercynian deformation in the Mauritanides and tectonic signifiance of gravity anomalies. Tectonophysics, 109, p. 41- 59
TAHIRI A. et HOEPFFNER Ch. (1987) – Importance des mouvements distensifs au Dévonien supérieur en Meseta nord occidentale (Maroc) : les calcaires démantelés de Tiliouine et de la ride d’Oulmès, prolongement orientale de la ride des Zaer. C. R. Acad. Sci. t. 306, série II, pp. 223.
TAHIRI A. (1991) – le Maroc central septentrional : stratigraphie, sédimentologie et tectonique du Paléozoïque ; un exemple de passage des zones internes aux zones externes de la chaîne hercynienne du Maroc. Thèse Sci., Univ. de Bretagne occidentale, Brest, 311 p.
TAHIRI A., SAIDI M. et AIT BRAHIM L. (1997) -Importance de la distension dans la bordure occidentale du Bassin dévono carbonifère de Sidi Bettache : la ride de l’oued Khellata (Meseta occidentale). 14ème Colloque des Bassins Sédimentaires Marocains, du 24 au 27/9/1997, Kenitra pp. 15-16.
VIESLET J.L. (1983) – Description d’une microfaune de Foraminifères à la base du Viséen moyen dans la région de Tiflet (Maroc). Bull. Soc. belg. Géol., t. 92, 4, pp. 273-291.
WIPPERN J. (1955) – Sur le granite de Taïcha, près de Tiflet (Meseta marocaine). Notes et Mém. Serv. géol. Maroc, 12, 125, p. 81-85.
ZAHRAOUI M. (1991- la plateforme carbonatée dévonienne du Maroc occidental et sa dislocation hercynienne. Thèse ès Sciences, UBO, Brest, 261 p.